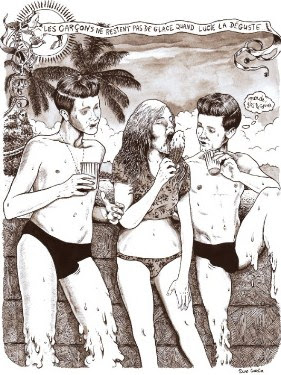(réalisé par Eugenio Polgovsky, 2008 et actuellement en salles)
A l’heure où les deux remakes pitoyables de la Guerre des boutons nous montrent des gamins lisses et mielleux à souhait, Los Herederos (Les héritiers) préfère s’immiscer, avec une sobriété toute autre, dans le quotidien d’enfants qui ont reçu un héritage dont ils se seraient bien passés : la misère. Eugenio Polgovsky, jeune documentariste, pose sa caméra aux quatre coins de la campagne mexicaine et filme, durant une journée, la vie de ces jeunes, âgés pour la plupart de 3 à 10 ans. Leur seule activité : travailler pour survivre (découpe de bois en pleine montagne, maçonnerie, récolte de tomates, etc.). Achevé en 2008 le film a vécu de festivals en festivals avant de sortir enfin sur les écrans français le 21 septembre dernier. Très peu distribué (à peine 7 salles sur tout le territoire en première semaine) il n’en reste pas moins un documentaire exemplaire, comme on aimerait en voir plus souvent.
Avec ce film Polgovsky s’impose comme un cinéaste, et a fortiori un journaliste, très talentueux. Il s’en remet à la seule expressivité du réel et ne charge le récit d’aucun commentaire en voix off. Un pari qui semble osé mais qu’il tient d’un bout à l’autre grâce à une science du cinéma vraiment impressionnante. A la manière d’un Raymond Depardon, sans rien dire, il dit tout ; car, par ailleurs, les niveaux de lecture sont multiples (travail des enfants, dérives du capitalisme, société de consommation, etc.) mais ils ne viennent pas polluer l’œuvre en elle-même, avant tout artistique. Pour ne pas tomber dans un misérabilisme dégoulinant, ce qui serait pourtant très facile avec un tel sujet, le réalisateur utilise une mise en scène subtile et un montage minutieux. Les enfants sont filmés, caméra à l’épaule, comme des petits aventuriers qui doivent surmonter divers épreuves (cf. les scènes dans la montagne). Ainsi le film oscille entre une réalité d’une violence parfois insoutenable et ce regard attendrissant qui créé une émotion sincère. Le montage cyclique des scènes de labeur finit par mécaniser les gestes des enfants, à tel point qu’on les perçoit parfois comme des petits adultes, évoluant dans un microcosme bien à eux, un peu comme si on se trouvait dans le monde de Peter Pan ou sur l’île de Sa Majesté des mouches.
En effet on ne voit presque aucun adulte, seulement des silhouettes ou des ombres fuyantes. Selon Polgovsky ce n’est pas un choix de sa part mais bien une réalité. Les parents, notamment les pères, partent souvent gagner de l’argent en ville. Reste donc les enfants…et les vieux. La vieillesse n’a ici rien à voir avec la sagesse, elle est au contraire montrée comme une décrépitude, le fardeau d’une existence écrasée par la pauvreté. Polgovsky n’hésite pas à faire des parallèles entre ces deux générations (des dos courbés, des regards vagues) ce qui renforce le côté tragique de ces vies.
C’est donc un Mexique à mille lieux des trafics de drogue et de l’immigration clandestine que l’on découvre. Le travail des enfants y est depuis longtemps dénoncé par les organisations internationales mais il reste un véritable tabou pour la population.
Los Herederos est définitivement un film à voir. Un exemple de travail journalistique, jamais complaisant, jamais putassier, soutenu par un cinéma inventif et léger. Une légèreté que l’on retrouve parfois chez les gosses, comme un sursaut d’innocence éphémère, au détour de chamailleries, de rires, ou de la magnifique scène de danse qui clôt le film.
Bande annonce
Punching Joe